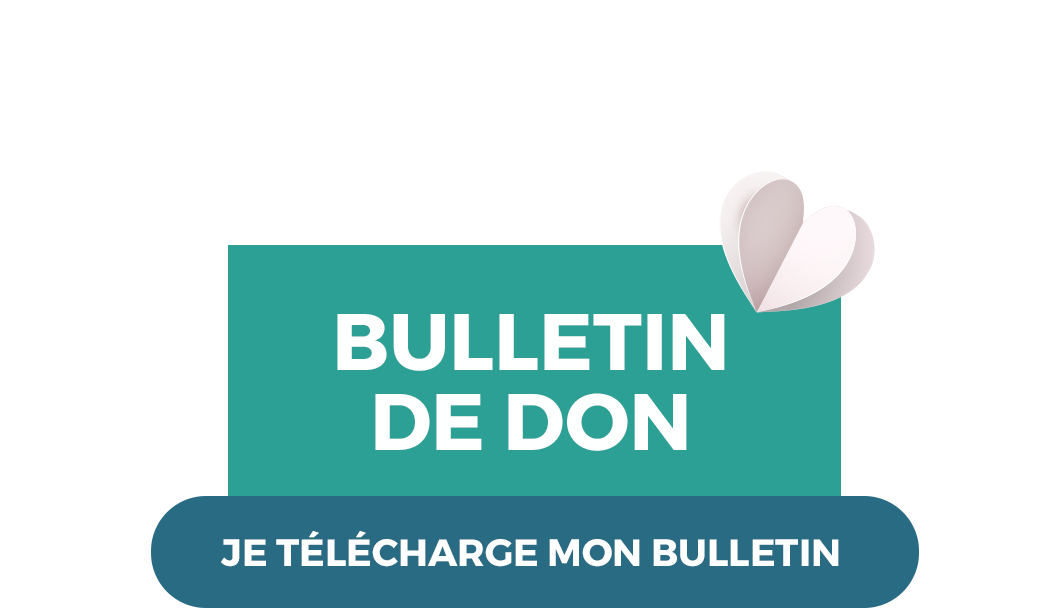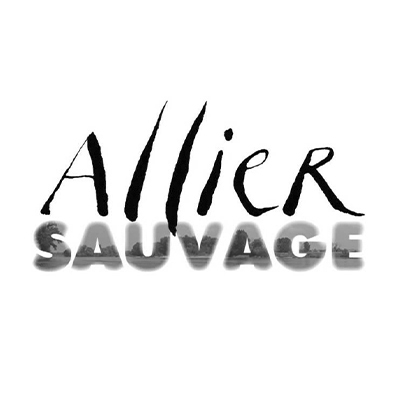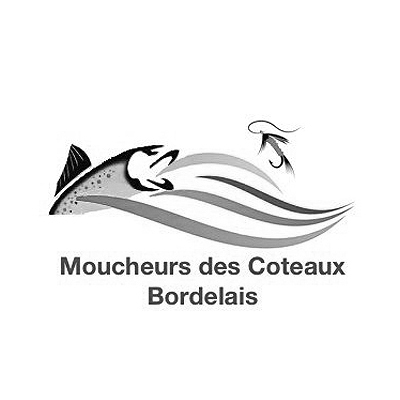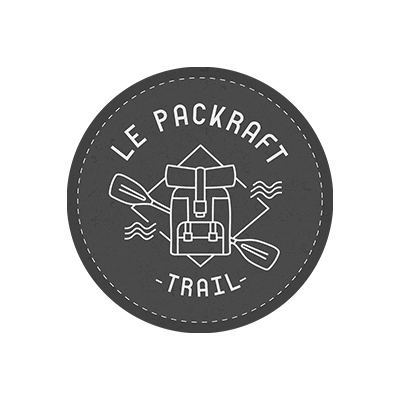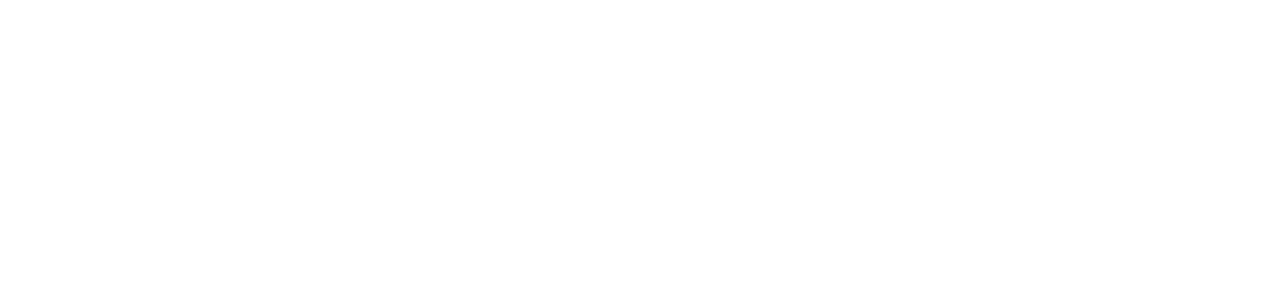
L’innovation d’urgence pour les rivières
Des rivières
Des hommes
Des territoires
Un fonds atypique
porté par l’innovation
et les dynamiques
collaboratives
Le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages a été créé en 2010,
avec l’appui du W.W.F.- France et du monde de la pêche afin de sauvegarder
nos rivières les plus « sauvages ». A l’époque, ces ultimes cours d’eau libres ne bénéficiaient pas de l’attention collective indispensable. En dépit de leur
biodiversité unique, il était possible d’y construire des grands barrages,
comme sur le Rizzanese en Corse. Il fallait inventer un mode de conservation
innovant, « ouvert et participatif », en collectant de l’argent privé, en
construisant des coopérations pionnières avec les O.N.G., institutions,
scientifiques, entreprises, fondations.
Le Fonds a mobilisé des moyens permettant de renforcer l’appropriation
des valeurs générées par la conservation des « rivières joyaux ».
La mission de départ est accomplie : un label de certification A.F.N.O.R.
– Association Française de Normalisation – « Site Rivières Sauvages »,
aujourd’hui mis en œuvre par « l’Association du Réseau des Rivières Sauvages »
a été créé en 2014.
Il repose sur une base scientifique, technique et humaine solide. 30 rivières
ont été labellisées avec une adhésion puissante des territoires ruraux et
l’appui d’institutions, dont l’Office Français de la Biodiversité, le Ministère
de la transition écologique, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
et le Conseil Départemental de l’Ain.
Après 15 années d’existence, le fonds fait évoluer sa mission et élargit son
objet. S’il continue à appuyer la sauvegarde des rares rivières encore sauvages,
il souhaite contribuer à la protection d’autres écosystèmes aquatiques moins
prestigieux : la renaturation des cours d’eau est un chantier d’avenir !
Il a lancé pour cela un important processus de transformation et d’évolution
depuis 2023, en renouvelant son Conseil d’Administration, en redéfinissant
son projet.
Un chantier au long cours. Bienvenue !
Initiateur
Incubateur
Opérateur
Collecteur
Distributeur
Le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages a été créé en 2010, avec l’appui du W.W.F.- France et du monde de la pêche afin de sauvegarder nos rivières les plus « sauvages ». A l’époque, ces ultimes cours d’eau libres ne bénéficiaient pas de l’attention collective indispensable. En dépit de leur biodiversité unique, il était possible d’y construire des grands barrages, comme sur le Rizzanese en Corse. Il fallait inventer un mode de conservation innovant, « ouvert et participatif », en collectant de l’argent privé, en construisant des coopérations pionnières avec les O.N.G., institutions, scientifiques, entreprises, fondations.
Le Fonds a mobilisé des moyens permettant de renforcer l’appropriation des valeurs générées par la conservation des « rivières joyaux ». La mission de départ est accomplie : un label de certification A.F.N.O.R. – Association Française de Normalisation – « Site Rivières Sauvages », aujourd’hui mis en œuvre par « l’Association du Réseau des Rivières Sauvages » a été créé en 2014. Il repose sur une base scientifique, technique et humaine solide.
30 rivières ont été labellisées avec une adhésion puissante des territoires ruraux et l’appui d’institutions, dont l’Office Français de la Biodiversité, le Ministère de la transition écologique, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et le Conseil Départemental de l’Ain.
Après 15 années d’existence, le fonds fait évoluer sa mission et élargit son objet. S’il continue à appuyer la sauvegarde des rares rivières encore sauvages, il souhaite contribuer à la protection d’autres écosystèmes aquatiques moins prestigieux : la renaturation des cours d’eau est un chantier d’avenir !
Il a lancé pour cela un important processus de transformation et d’évolution depuis 2023, en renouvelant son Conseil d’Administration, en redéfinissant son projet.
Un chantier au long cours. Bienvenue !
Initiateur
Incubateur
Opérateur
Collecteur
Distributeur
lE CONSEIL
SCIENTIFIQUE
LE FONDS EST DOTÉ D’UN CONSEIL SCIENTIFIQUE AUTONOME ET INDÉPENDANT POURSUIVANT 4 OBJECTIFS :
– 1 –
Éclairer le fonds sur les actions à conduire aujourd’hui pour demain afin d’optimiser la portée des aides versées par le fonds au titre des actions locales.
– 2 –
Développer les partenariats scientifiques et techniques pour installer durablement le fonds dans le paysage de la conservation de la nature.
– 3 –
Appuyer les réponses du fonds aux appels à projets lancés par les financeurs potentiels dans le but de les convaincre du bien-fondé scientifique des réponses.
– 4 –
Représenter le fonds à l’occasion de colloques et séminaires scientifiques, voire dans le cadre de projets scientifiques, techniques ou pédagogiques



Les chantiers

Le fonds est présent et représenté au sein du Comité français de l’Union Internationale de Conservation de la Nature – U.I.C.N – dans les groupes thématiques : Wilderness et Nature Férale, Montagne et Espaces en Libre Evolution. Le fonds est membre du Comité National de l’Eau – C.N.E. – et de l’Alliance pour les Zones Humides.
Le fonds est adhérent du Centre Français des Fonds et Fondations – C.F.F. – et de l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial – ADMICAL –.
la communauté
collaborative
Le Fonds bénéficie du soutien d’une communauté opérationnelle de 32 acteurs
impliqués dans les enjeux de protection de biodiversité des rivières.
Ces derniers, partagent son éthique, ses valeurs et ses méthodologies d’actions.
les fondations et fonds
qui nous soutiennent
la structuration du dispositif et le développement des actions collectives
engagées avec les autres O.N.G.
les entreprises
mécènes
apporte des financements tant au niveau national que pour
des actions concrètes sur les territoires.
les entreprises membres
du collectif « 1% pour la planète«
Qu’est-ce que « 1% for the Planet » ?
Lancée en 2002 aux Etats-Unis par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et Craig Mathews, ex-propriétaire de Blue Ribbon Flies, «1 % pour la planète » est une organisation à but non lucratif. Le fonctionnement du collectif repose sur un modèle simple et efficace : engager les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales agréées, afin d’augmenter leur impact.
Les entreprises membres – plus de 1100 en France – choisissent les projets qu’elles souhaitent soutenir parmi ceux vérifiés par l’organisation.
L’objectif des fondateurs étant de démontrer que les entreprises peuvent prospérer tout en contribuant au bien commun